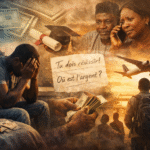Résumé exécutif
Quand les groupes marginalisés nomment l’injustice, les structures de pouvoir et une partie de l’opinion publique répondent typiquement par trois accusations : « vous divisez », « vous vous repliez sur vous-mêmes », et « vous voulez tout prendre ». Ce mécanisme n’est ni propre au Cameroun ni récent. Des schémas similaires ont émergé avec les mouvements pour les droits civiques afro-américains aux États-Unis (étiquetés comme « fauteurs de troubles »), les militants anti-apartheid en Afrique du Sud (qualifiés de « terroristes »), les populations tutsi dans le Rwanda d’avant 1994 (fantasmées comme « hégémoniques »), les communautés igbo dans le Nigeria post-Biafra (soupçonnées de rechercher la « domination »), ou les peuples autochtones accusés de « séparatisme » lorsqu’ils revendiquent leurs droits.
Au Cameroun, la bamiphobie s’enracine dans l’héritage colonial, s’institutionnalise après l’indépendance à travers la répression et la stigmatisation politique, et se perpétue aujourd’hui via les médias, les bureaucraties et les réseaux sociaux. Promouvoir la culture sans défendre les droits réduit finalement l’identité au folklore—la danse sans la dignité, le pagne traditionnel sans la voix. Un agenda culturel robuste nécessite une colonne vertébrale civique et un horizon de justice.
I. Pourquoi la voix des marginalisés est-elle immédiatement disqualifiée ?
La « sécuritisation » du discours
Nommer la discrimination est recadré comme une menace à l’unité. Les plaintes se transforment en « dangers », les alertes deviennent « haine ». Ce glissement sémantique permet aux structures de pouvoir de se présenter comme gardiennes de la paix tout en maintenant le statu quo. Comme le note le politologue Ole Wæver dans ses travaux sur la théorie de la sécuritisation : « Un enjeu devient une question de sécurité non pas nécessairement parce qu’une menace existentielle réelle existe, mais parce que la question est présentée comme une telle menace. »
Le blâme de la victime (inversion accusatoire)
Le groupe ciblé porte la responsabilité du conflit : « S’ils réussissent, c’est qu’ils veulent dominer ; s’ils dénoncent, c’est qu’ils veulent diviser. » Cette logique inverse les causalités et neutralise la critique. Le psychologue William Ryan, qui a forgé le terme « blâmer la victime », a observé comment ce mécanisme « se concentre sur les défauts de la victime plutôt que sur les défauts de la situation ».
La « politique de respectabilité »
Les victimes se résolvent à souffrir en silence pour « éviter d’attiser les tensions ». Cette injonction, observée dans divers contextes, nourrit une spirale intergénérationnelle du silence où les aînés conseillent : « Travaille dur, évite la politique. » Le politologue Frederick Harris décrit la politique de respectabilité comme « une stratégie politique utilisée par les groupes marginalisés pour obtenir respect et droits du groupe dominant en démontrant leur valeur et leur adhésion aux normes du groupe dominant ».
Le « whataboutisme » et la confusion délibérée
Toute dénonciation se noie dans le relativisme : « Et les autres ? » « Tout le monde souffre ! » Résultat : dilution des faits, déni des spécificités, fuite des responsabilités. Cette technique, largement documentée durant l’ère soviétique, détourne la critique en changeant de sujet plutôt qu’en abordant les questions substantielles.
L’hostilité horizontale
Dans les contextes de rareté et de compétition clientéliste, les groupes dominés se battent entre eux tandis que les structures de pouvoir restent intactes. Cette dynamique alimente les critiques venant de certains Bamiléké eux-mêmes—ce que la psychologue sociale Susan Fiske qualifie d’« agression horizontale » dans ses recherches sur les préjugés et les hiérarchies sociales.
II. Le cas camerounais : couches historiques et architecture politique
Héritage colonial et post-indépendance
La combinaison éthique du travail, entrepreneuriat et solidarité financière (tontines) fut interprétée dès l’époque coloniale comme un potentiel subversif. L’après-indépendance a renforcé l’étiquette de « menace » à travers les zones « pacifiées » et les dirigeants politiques assassinés ou bannis. Résultat : trauma, stratégies de survie, retrait de la politique vers l’économie.
La caractérisation de l’officier colonial Jean-Marie Lamberton en 1960 cristallise cette mentalité : « Le Cameroun s’engage sur les chemins de l’indépendance avec, dans sa chaussure, un caillou bien gênant. Ce caillou, c’est la présence d’une minorité ethnique : Les Bamiléké. » Cette métaphore a établi un cadre que les gouvernements successifs ont maintenu.
Réalité institutionnelle présente
Des épisodes connus—émeutes ciblées, campagnes médiatiques, disputes religieuses ou universitaires, déclarations publiques stigmatisantes, sur-judiciarisation de certains militants—composent un régime de signes signalant des frontières tacites limitant l’accès à la représentation, au récit et à la dignité. Le message reçu est clair : « Réussissez sans faire d’ombre et sans parler. »
Le cas du Professeur Maurice Kamto illustre ce schéma. Tandis que les candidats présidentiels du Nord comme Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma reçoivent un soutien régional explicite sans critique, Kamto a fait face à des accusations de tribalisme et de séparatisme, démontrant ce que l’intellectuel Achille Mbembe appelle l’instrumentalisation du sentiment anti-bamiléké comme « technologie de pouvoir ».
Culture vs. droits : le piège de la folklorisation
Nombre d’associations préfèrent le terrain « neutre » du patrimoine—festivals, masques, gastronomie—un espace moins risqué que le plaidoyer. Sans horizon civique, la culture devient spectacle plutôt que puissance sociale. Le concept de « transcripts cachés » de l’anthropologue James Scott aide à expliquer comment les groupes dominés expriment souvent la résistance à travers des formes culturelles tout en évitant la confrontation politique directe.
La diaspora : espace de liberté et dilemme
Hors du pays, on peut parler plus fort, structurer des think tanks, financer des mémoriaux, documenter les violations. Mais les coûts perçus—impact sur les affaires, la famille restée au pays, l’accès à la patrie—conduisent certains à dissocier célébration culturelle et action politique.
III. Comparaisons utiles (sans confondre les histoires)
États-Unis
Pendant des décennies, exiger des droits civiques fut accusé de « diviser la nation ». Le renversement est venu par des alliances larges, des batailles juridiques et des cadres moraux universalisants. Martin Luther King Jr. nota : « Nous qui nous engageons dans l’action directe non-violente ne sommes pas les créateurs de tension. Nous ne faisons que porter à la surface la tension cachée qui est déjà vivante. »
Afrique du Sud
Criminalisation des militants ; solution : mobilisation internationale, documentation rigoureuse, récit unifié des injustices. La stratégie du mouvement anti-apartheid combinant expression culturelle et résistance politique offre des parallèles instructifs, comme documenté par des intellectuels comme Steven Biko et Frantz Fanon.
Rwanda d’avant 1994 / Nigeria post-Biafra
L’obsession de la menace « hégémonique » a justifié exclusion et violences—avertissement sur le pouvoir des récits et des plateformes radio/numériques. Le politologue Scott Straus note comment la « peur ethnique » devient un outil mobilisateur qui peut mener à la violence extrême lorsque combinée à la compétition politique.
Leçon transversale : Données, alliances, cadres moraux inclusifs et infrastructures de mémoire servent d’antidotes aux campagnes de délégitimation.
IV. Diagnostic structuré : où en sommes-nous ?
Trauma mémoriel : La transmission a été fragmentée, souvent clandestine, créant ce que la psychologue Maria Yellow Horse Brave Heart appelle « trauma historique »—blessures émotionnelles et psychologiques cumulatives transmises à travers les générations.
Risque individuel élevé : Dénoncer peut coûter cher (économie, carrière, sécurité), créant ce que le sociologue James C. Scott appelle « falsification des préférences »—conformité publique malgré la dissidence privée.
Organisations « culturelles » sans colonne vertébrale civique : Visibilité sans pouvoir, résultant en ce que la critique culturelle Gayatri Spivak identifie comme « essentialisme stratégique »—souligner l’identité culturelle tout en évitant la confrontation politique.
Écosystème médiatique : Asymétrie d’accès, cadrage biaisé, algorithmes amplifiant la haine. Les recherches de la spécialiste en communication Zeynep Tufekci démontrent comment les plateformes numériques peuvent accélérer la polarisation ethnique.
Droit et institutions : Outils de recours sous-utilisés, manque de contentieux stratégiques, reflétant ce que le juriste Gerald Rosenberg appelle l’« espoir creux » du changement social centré sur les tribunaux sans mobilisation plus large.
Récit national : « Unité » confondue avec silence, équilibres avec équité, exemplifiant ce que le théoricien politique Benedict Anderson nomme « communauté imaginée » basée sur l’exclusion plutôt que l’inclusion.
V. Réponses stratégiques : du constat à la capacité d’action
1) Recadrement
Passer de « problème bamiléké » à « problème républicain » : lutter contre la bamiphobie renforce la nation. Éviter le récit ethnocentrique en s’ancrant dans l’égalité civique et les droits réciproques. Comme le dit le constitutionnaliste Jürgen Habermas, les communautés politiques légitimes nécessitent un « patriotisme constitutionnel » basé sur des valeurs civiques partagées plutôt que l’identité ethnique.
2) Preuves, pas seulement plaintes
Observatoire des incidents : Base de données vérifiée du discours, discrimination, violence avec cartographie et séries temporelles. Les stratégies de documentation utilisées avec succès par Human Rights Watch et Amnesty International fournissent des modèles méthodologiques.
Contentieux stratégiques : Choisir des cas phares, poursuivre via les juridictions régionales/internationales. La Cour interaméricaine des droits de l’homme et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples offrent des plateformes potentielles.
3) Alliances transversales
Construire des coalitions Nord-Sud-Est-Ouest autour de principes (procès équitables, médias publics équitables, réforme électorale), pas d’origines. Plus le « nous » est large, plus les accusations de « division » s’effondrent. Les recherches du politologue Sidney Tarrow sur les mouvements sociaux soulignent comment la mobilisation réussie nécessite de transcender les frontières étroites de groupe.
4) Puissance culturelle augmentée
Transformer les festivals en agoras civiques : expositions mémorielles, tables rondes, lectures d’archives, ateliers de droits. Culture + Droit = transformation sociale. Les travaux de l’anthropologue James C. Scott sur les « arts de la résistance » démontrent comment les formes culturelles peuvent porter des messages politiques.
5) Diaspora comme levier systémique
- Think tanks et fonds de contentieux
- Programmes de retour de compétences
- Mentorat et bourses pour la jeunesse
- Plateformes médias multilingues pour internationaliser le récit
Les recherches de la spécialiste des migrations Peggy Levitt sur les « villageois transnationaux » montrent comment les communautés diasporiques peuvent efficacement influencer la politique de la patrie à travers l’organisation stratégique.
6) Éducation et médias
- Modules d’histoire plurielle scolaires
- Charte médiatique contre la stigmatisation
- Formation au fact-checking et à la littératie numérique
Les stratégies de réforme éducative employées dans les sociétés post-conflit comme le Rwanda et l’Afrique du Sud offrent des modèles pertinents, bien qu’adaptés aux contextes spécifiques.
7) Mémoire et réparation
- Journées officielles de souvenir
- Appels à une Commission Vérité-Mémoire-Réparations
- Patrimonialisation des lieux de trauma (pédagogie, pas vengeance)
Les commissions vérité au Chili, en Afrique du Sud et au Pérou fournissent des cadres pour aborder les injustices historiques tout en promouvant la réconciliation.
VI. Répondre aux objections courantes
« Vous divisez » → Exiger l’égalité répare le tissu national. L’oubli forcé est la vraie fracture. Comme l’observait Nelson Mandela : « Il ne peut y avoir de révélation plus vive de l’âme d’une société que la façon dont elle traite ses enfants et ses minorités. »
« Repli identitaire » → Les revendications concernent des droits universels, pas des privilèges. La Déclaration universelle des droits de l’homme fournit le cadre normatif pour ces demandes.
« Vous voulez tout prendre » → Déployer des indicateurs objectifs (accès aux médias, représentation dans la fonction publique, justice) et réclamer des procédures équitables pour tous. La mesure empirique, comme prônée par des sociologues comme Thomas Piketty dans l’étude des inégalités, fournit des fondations objectives pour les revendications d’équité.
Conclusion : Culture avec colonne vertébrale
On peut promouvoir la culture sans faire de politique partisane ; on ne peut pas maintenir la dignité culturelle sans défendre les droits fondamentaux du groupe qui la porte. L’équation est simple : mémoire + données + alliances + institutions. Nommer la bamiphobie ne fracture pas la nation ; cela l’aligne avec son idéal républicain.
Comme le clame le philosophe politique John Rawls dans « Théorie de la justice », une société véritablement juste doit s’assurer que les inégalités sociales et économiques œuvrent au bénéfice des membres les plus défavorisés. Appliquer ce principe aux dynamiques ethniques du Cameroun révèle comment aborder la bamiphobie sert une consolidation démocratique plus large.
Boussole stratégique :
Court terme : Documentation, protection juridique, codes de conduite médiatiques
Moyen terme : Coalitions citoyennes, réforme procédurale, éducation civique
Long terme : Mémoire partagée, réparations symboliques, égalité normalisée
Un peuple qui se souvient résiste. Un peuple qui s’organise persuade. Un peuple qui documente gagne.
La transformation du grief en gouvernance, de la mémoire en politique, et de la dignité en démocratie nécessite ce que le sociologue Charles Tilly appelle la « politique contentieuse »—interaction soutenue entre challengers et autorités qui peut remodeler les relations de pouvoir. La question bamiléké, correctement cadrée et stratégiquement poursuivie, offre au Cameroun une opportunité d’approfondir ses fondations démocratiques plutôt que de les menacer.
L’auteur reconnaît le travail de documentation extensif de La’akam, les contributions analytiques d’intellectuels comme Achille Mbembe, Patrice Nganang et Mongo Beti, et les témoignages de nombreux individus qui ont brisé le silence pour nommer l’injustice et exiger la justice.
Voici la bibliographie complète des sources citées dans l’article :
Bibliographie
Ouvrages théoriques et académiques
Anderson, Benedict. L’imaginaire national : Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme. Paris : La Découverte, 1996.
Biko, Steven. I Write What I Like. Londres : Bowerdean Press, 1978.
Fanon, Frantz. Les Damnés de la terre. Paris : Maspero, 1961.
Fiske, Susan T. Social Cognition: From Brains to Culture. Londres : Sage Publications, 2013.
Habermas, Jürgen. L’Intégration républicaine : Essais de théorie politique. Paris : Fayard, 1998.
Harris, Frederick C. The Price of the Ticket: Barack Obama and the Rise and Decline of Black Politics. Oxford : Oxford University Press, 2012.
King Jr., Martin Luther. Letter from Birmingham Jail. 1963.
Levitt, Peggy. The Transnational Villagers. Berkeley : University of California Press, 2001.
Rawls, John. Théorie de la justice. Paris : Seuil, 1987.
Rosenberg, Gerald N. The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change? Chicago : University of Chicago Press, 1991.
Ryan, William. Blaming the Victim. New York : Pantheon Books, 1971.
Scott, James C. Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven : Yale University Press, 1990.
Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak? Dans Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana : University of Illinois Press, 1988.
Straus, Scott. Making and Unmaking Nations: War, Leadership, and Genocide in Modern Africa. Ithaca : Cornell University Press, 2015.
Tarrow, Sidney. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
Tilly, Charles. Contentious Politics. Boulder : Paradigm Publishers, 2007.
Tufekci, Zeynep. Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. New Haven : Yale University Press, 2017.
Wæver, Ole. « Securitization and Desecuritization. » Dans On Security, sous la direction de Ronnie D. Lipschutz. New York : Columbia University Press, 1995.
Yellow Horse Brave Heart, Maria. « The Historical Trauma Response Among Natives and Its Relationship with Substance Abuse. » Psychoactive Drugs 35, no. 1 (2003): 7-13.
Sources spécifiques au contexte camerounais
Lamberton, Jean-Marie. « Les Bamiléké dans le Cameroun d’aujourd’hui. » Revue française d’études politiques africaines, mars 1960.
Mbembe, Achille. De la postcolonie : Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Paris : Karthala, 2000.
Nganang, Patrice. Manifeste d’une nouvelle littérature africaine. Paris : Homnisphères, 2007.
Beti, Mongo. Main basse sur le Cameroun : Autopsie d’une décolonisation. Paris : Maspero, 1972.
Documents et rapports
Human Rights Watch. Cameroon: Harassment of Opposition Supporters. New York : HRW, 2018.
Amnesty International. Cameroon: Human Rights Under Attack. Londres : Amnesty International Publications, 2019.
Commissions Vérité (références comparatives)
Commission Vérité et Réconciliation d’Afrique du Sud. Rapport final. Le Cap : Juta, 1998.
Commission Nationale de Vérité et Réconciliation du Chili. Rapport Rettig. Santiago : Gouvernement du Chili, 1991.
Commission de la Vérité et de la Réconciliation du Pérou. Rapport final. Lima : CVR, 2003.
Institutions internationales
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Statut et Règlement. Arusha : CADHP, 2010.
Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme. Jurisprudence sélectionnée sur les droits des minorités. San José : CIDH, 2020.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Nations Unies, 1948.