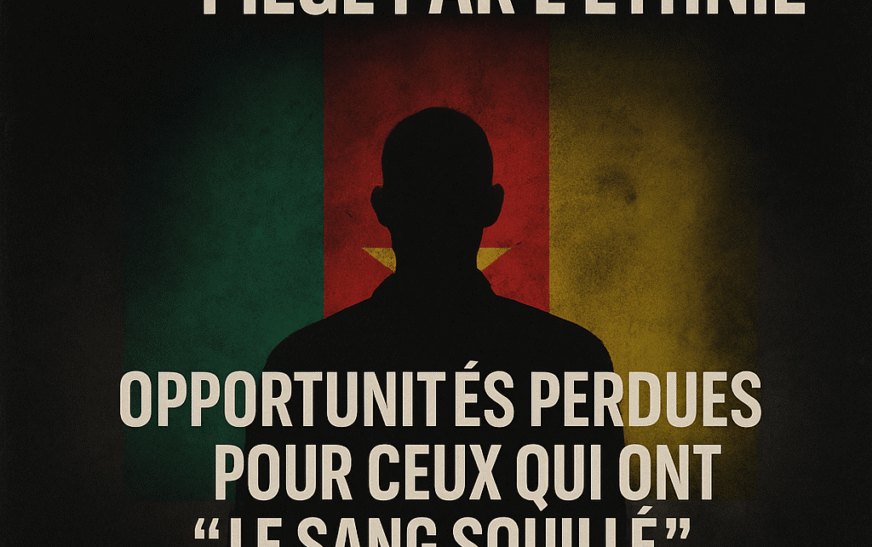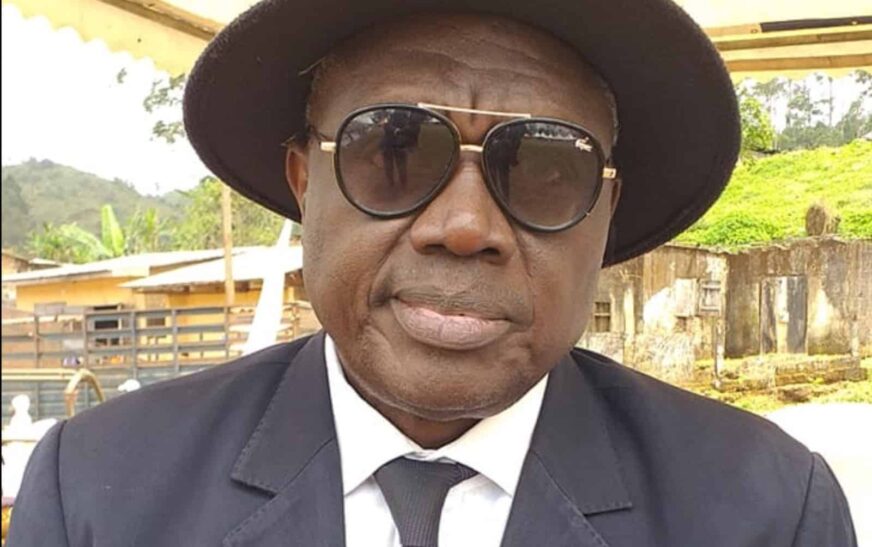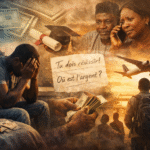« Un Bamiléké à Etoudi? jamais!. »
Cette phrase, attribuée à Joseph Owona, a longtemps circulé comme une rumeur malveillante. Aujourd’hui, depuis l’invalidation de la candidature du Professeur Maurice Kamto, elle résonne comme une sentence gravée dans le marbre.
Pour beaucoup de jeunes, c’est la preuve que le plafond de verre ethnique n’est pas une illusion mais une réalité politique, économique et sociale.
Quand l’origine devient un délit
« Au Cameroun, j’ai voulu ouvrir un centre de formation professionnelle dans ma ville natale. J’avais les financements, les autorisations ministérielles, tout. Mais dès qu’on a su que j’étais Bamiléké, les choses ont traîné… puis bloquées. On m’a suggéré officieusement de m’associer à une « personne de confiance ». Comprenez : « quelqu’un du bon clan. »
— Pauline, entrepreneure dans la diaspora
Son témoignage n’est pas isolé.
À l’Ouest, les commandants de brigades, commissaires, sous-préfets et la majorité des autorités occupant des postes stratégiques viennent presque tous du même clan, renforçant la perception d’un contrôle politique et sécuritaire du peuple grassfield.
Les récits abondent sur des opportunités ratées par des Camerounais qui ont «le sang souillé», autrement dit un parent non-Bulu.
Le mérite, cette variable étrangère
La frustration grandit chez ces jeunes qui :
- réussissent les concours d’accès aux grandes écoles à l’étranger,
- décrochent des postes à haute responsabilité dans des multinationales,
- innovent dans des environnements compétitifs…
… mais se voient barrer la route dans leur propre pays par un système où le piston, le clan et la servilité priment sur la compétence.
Même en uniforme, le mur est là
Dans l’armée et la police, les témoignages se multiplient :
- promotions gelées,
- affectations marginalisantes,
- suspicion permanente.
Les grades se gagnent souvent moins par bravoure ou compétence que par proximité tribale et loyauté politique.
Le choix de partir… ou de contourner
Face à cette réalité, de plus en plus de jeunes de la diaspora choisissent de :
- Investir dans leurs pays d’accueil,
- S’implanter dans d’autres pays africains perçus comme plus équitables,
- Mettre leur savoir-faire au service de causes transnationales, plutôt que d’un système qui les rejette.
Pour eux, ce n’est pas fuir. C’est refuser de perdre leur vie à attendre qu’on les laisse exister pleinement.
Appel à l’action
Il est temps de briser ce cercle vicieux.
- Nommer le problème : l’ethnicisme institutionnalisé.
- Documenter les injustices pour bâtir une preuve collective.
- Créer des réseaux économiques, académiques et citoyens autonomes, capables de fonctionner hors des filtres discriminatoires.
- Exiger la transparence dans les concours, recrutements et investissements publics.
Car un pays qui humilie ses talents au nom de l’ethnie creuse sa propre tombe.
Et si la jeunesse ne prend pas la parole maintenant, d’autres continueront à écrire à sa place l’histoire de son effacement.
Un pays qui humilie ses talents au nom de l’ethnie creuse sa propre tombe.